On connaît Jean-Pierre Mocky cinéaste provocateur et trublion public, moins comme exploitant rompu au mystère des salles obscures. Entre Mocky et les salles de cinéma, c’est une longue histoire d’amour. Si celle avec le Brady, mythique cinéma de quartier du 10ème dont il s’occupait depuis presque vingt ans, vient de se terminer, une autre s’apprête à débuter : Mocky vient en effet de racheter le non moins légendaire Action École dans le Quartier latin. L’occasion pour nous de questionner « M le Mocky » sur cette passion discrète mais durable à l’occasion d’un rendez-vous dans son repère niché sur les bords de la Seine. Que représente la salle de cinéma pour un cinéaste ? Est-ce un moyen d’entretenir un dialogue avec son public ? Réponses en vrac teintées de nostalgie.
Le Louxor, ça vous évoque quoi ?
Le Louxor, ça faisait partie de ce qu’on appelait les « bateaux », d’immenses salles de 1 000 à 1 500 places. Il y avait le Marcadet, le Victor Hugo, l’Avron, le Palais des fêtes, le palais Rochechouart… des salles qui étaient toujours bourrées à craquer. A l’époque, les films sortaient d’abord dans quelques cinémas, sur les Champs par exemple, avec un prix de billet de 6 francs. Puis ils sortaient à un tarif moins cher dans tous les bateaux en même temps, pour la deuxième exclusivité. Ces salles ramassaient les spectateurs qui avaient moins de moyens. Il faut savoir que les bateaux ne montraient des films que le soir. Comme en province, on jouait le soir à 21h – à part le week-end où c’était permanent. Toutes ces salles se sont transformées en supermarchés, avec la domination de la télé dans les années 1970.
Le Louxor a eu une histoire mouvementée…
Le Louxor ne s’est pas reconverti en magasin car il était classé. Ouaki, qui l’avait racheté, voulait agrandir Tati mais la mairie, qui possédait les murs, lui a refusé ces travaux. C’était un religieux, un mystique, alors il a confié un moment la salle à une sorte de secte ou de branche religieuse, je ne sais pas ce qu’ils foutaient là-dedans.
Avez-vous des souvenirs de la grande époque du Louxor ?
On y allait avec Truffaut, Alain Resnais… on était tout le temps fourrés au cinéma, on n’avait pas la télévision. Le Louxor passait des westerns, des films américains ou français… Il y avait des loges, comme dans un théâtre, les amoureux venaient dans ces loges pour s’embrasser. J’y ai sorti un film : Un drôle de paroissien.
Vous êtes cinéaste et exploitant en même temps. Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre le Brady en 1994 ?
Le Brady, on a voulu le reprendre avec Godard pour y projeter nos films, mais Godard a laissé tomber car il n’avait pas la bosse d’un exploitant. Le fond de commerce du Brady, c’était le cinéma de série B, qui a peu à peu été dévoré par les grosses productions : les studios se sont mis à faire des gros films avec des sujets qui étaient d’abord l’apanage de ces petites productions – la bagnole qui bouffait les gens, les loups-garous… Le Brady ne pouvait pas se les payer, il s’est donc retrouvé sans films. Il y a eu une tentative de faire dans le porno soft, mais ça n’a pas marché. La vieille dame de 92 ans qui tenait le Brady m’a alors dit : « Mocky reprenez le faites-en quelque chose ». Pendant 16 ans on a essayé d’attirer mes spectateurs là-bas, mais j’ai 78 ans et la génération des gens qui constitue mon public avait un peu peur d’aller dans le quartier. Finalement, j’ai passé mes films, du Bollywood, et Tarantino est devenu le parrain. Je présentais mes films mais personne ne venait : les gens disaient « il est là le samedi » et ça devenait banal.
Vous venez de racheter l’Action École dans le Quartier latin…
Au Brady je n’étais pas dans mon quartier. En 1994, il n’y avait pas d’autre cinéma à vendre, alors j’ai racheté celui-là. Mais c’était un peu comme ouvrir un restaurant polonais dans un quartier où on ne mange que des steaks frites… Je me suis donc retourné sur l’Action École, car je pense qu’il est plus aisé d’accès pour mon public, avec en plus un grand nombre étudiants. On va l’appeler « Mocky Circus » et on va essayer d’y installer un petit cours d’art dramatique dans une des deux salles, pendant la journée. Dans l’autre salle, on diffusera en HD et en numérique. On va repasser plein de films, les miens, et des films rares. Ça commence en février.
Un cours dramatique ?
L’idée vient du fait que j’ai une haine contre le Cours Florent : les professeurs ne sont pas canons et il gardent trop de gens. On ne peut pas voir les cours comme une entreprise commerciale, moi, je veux un cours pour 30 personnes. Dans notre classe du Conservatoire, on était 40, on a sorti Belmondo, Cremer, Girardot, Rochefort, Noiret… Mais nous avions des gens de la trempe de Louis Jouvet comme profs ! Aujourd’hui les profs, c’est n’importe qui. Il faut aussi assez de sévérité pour ne garder que les bons élèves. Nous on veut sélectionner. J’aurai sûrement le même problème que le père Florent : il est impossible de payer des gens de la stature d’un Jouvet. Mais j’aimerais prendre des répétiteurs pour faire travailler les gens, tout en ayant quelques noms du métier. Un cours c’est une direction, Florent ne sait même pas jouer ! Il faut prendre des profs, mais moi, ou Lonsdale, ou Aumont ou des gens comme ça surveilleront les cours. Je me vois comme un maître baigneur. Pour l’instant je n’ai pas les moyens d’avoir des gens comme Lonsdale, mais je vais essayer de faire ça. J’ai été secrétaire de Stroheim ou Jules Berri, c’était des gens qui vous impressionnaient. Moi-même, j’étais impressionné par Fernandel, Michel Simon… Aujourd’hui j’aime bien certains acteurs, comme, Didier Bourdon, mais ils ne m’impressionnent pas du tout. Passer une scène devant Jouvet, ça imposait de tout donner. C’est la même différence qu’entre un petit médecin de campagne ou un grand spécialiste qui va vous sauver.
Comment trouvez-vous le temps pour tout ça ?
Vous savez, cette année j’ai réalisé trois films. J’ai tourné Les Insomniaques en 14 jours, puis une comédie que j’aime beaucoup, qui s’appelle Crédit pour tous, en 13 jours… Et je viens de terminer Dossier Toronto en 9 jours. Faites le calcul : ça fait à peine 40 jours dans l’année, il me reste du temps !
Malgré l’expérience du Brady, vous trouvez donc un certain plaisir à vous occuper d’une salle ?
A 78 ans, l’important c’est de se faire plaisir. Une salle c’est une danseuse, ou disons une maîtresse : les gens qui ont une maîtresse sont obligés de les payer – on n’a pas une maîtresse gratos quand on est vieux ou pas très beau, ou c’est très rare ! Alors on se paye une maîtresse, ça coûte de l’argent. L’avantage avec un petit cinéma que l’on rachète, c’est que ça ne coûte rien. Avoir une maîtresse qui ne vous coûte rien c’est formidable ! Vous avez le plaisir et ça ne vous coûte pas un rond. Le Brady, ça ne me rapportait que 500 euros par mois, mais ça ne perdait pas. Maintenant, gagner de l’argent avec une maîtresse, c’est autre chose !
Vous semblez néanmoins assez pessimiste par rapport à l’avenir des salles…
Nos enfants n’iront plus au cinéma. Le cinéma est mort parce qu’il y a beaucoup trop de films qui sortent chaque semaine. J’ai trois films terminés, je ne les sors pas, je les sortirai directement en DVD. Vous savez, j’ai vendu 540 000 cassettes de mes films chez Pathé. Mon dernier film a coûté 38000 euros mais je gagne plus d’argent dessus que Tavernier avec son film à 13 millions ! Pour Astérix, ils ont gagné deux millions sur les cent millions de budget. Moi je gagne 200 000 euros sur un film. Il y a aussi la télé : pour Colère, j’ai gagné ma vie, j’ai eu 3 300 000 spectateurs, c’est aussi une solution. Le secret, c’est l’indépendance : j’ai vu des jeunes qui ont fait des films à 15 000 dollars. Quand vous ne faites pas un film à la Régis Wargnier, personne ne peut vous empêcher de tourner. Un devis de 50 000 euros, ça ne fait pas peur aux assurances.
La sortie en salles vous semble de moins en moins importante ?
Il faut savoir qu’à Paris, il y 200 000 spectateurs qui sont toujours les mêmes, qui forment un petit bataillon : ils veulent tous voir le dernier film à la mode, comme le dernier Ozon, pour pouvoir dire « j’ai vu le dernier film de machin ». Après il y a le public que j’appelle intello : c’est un autre noyau, de 40 ou 50 000 spectateurs, qui vont voir des films argentins, iraniens, etc. Enfin, il y a le public des fans et des inconditionnels d’un cinéaste, comme Jarmusch, etc. Je pense faire partie de cette tranche, mais ça se limite à un noyau de 30 000 spectateurs. En sortant directement en DVD, j’attire un arrière banc d’inconditionnels : on va directement à son public.
Que vous évoque la renaissance du Louxor dans ce cadre ?
Il faut en revenir au problème de l’art et essai et de la communication avec le public. J’ai vu l’extinction des cinés club à cause de professeurs d’université qui se piquent d’être des spécialistes : on entre alors dans Les Précieuses ridicules de Molière… ces gens, au lieu de comprendre ce que le public aime ou voudrait voir, essaient de lui imposer des choses comme si c’était des suppositoires ou qu’on voulait lui faire avaler de l’huile de foie de morue. Un ouvrier ou un immigré sont aussi intelligents que vous et moi, mais ils sont « en direct » avec le cinéma : il faut répondre à cette attente plutôt que leur présenter du Robbe-Grillet… Il faut faire attention à ne pas confier le Louxor à un imbécile !
Comment imaginez-vous les choses ?
Je souhaite au Louxor de ne pas se planter ! J’espère qu’ils comprendront bien la chose. Mon fils s’est longtemps occupé du TNP de Saint-Denis, mais il a joué des pièces qui ne marchaient pas, il a fait un déficit de 6 milliards (d’anciens Francs, environ 10 millions d’Euros NDLR). Le Louxor, moi j’en aurais fait un music-hall, le Trianon a réussi là-dedans. La culture ça ne se manipule pas facilement, il ne faut pas l’imposer. Il faudrait envoyer des Savary, des gens comme ça, qui font des comédies musicales. Le Châtelet à Barbès ce serait parfait.
Peut-être s’agit-il avant tout de garder un lien populaire ?
Je me souviens qu’au Brady, on s’est mis à passer des films commerciaux turcs, c’était une vraie manne. On n’a jamais fait autant d’entrées. On a passé une version turque des Visiteurs, ça a fait un malheur, les familles entières venaient. On a cassé la baraque !
Propos recueillis par Vincent Malausa le 28 décembre 2010
Portrait de Jean-Pierre Mocky réalisé par Frédéric Poletti.
Frédéric Poletti est photographe, il vit et travaille à Paris 18ème . Son travail pour les Cahiers du Cinéma “Photographe aux Cahiers du Cinéma” a été exposé à l’Institut Français de Prague, à l’Institut Français de Kiev et aux Transphotographiques de Lille. Il collabore aujourd’hui avec la presse internationale, la mode et la publicité . (lien)

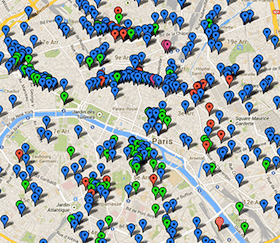


C’est touchant la parole d’un artiste qui a cru à l’exploitation, mais je ne partage pas son pessimisme. le Louxor, bien que sur le même territoire, a l’avantage d’être au croisement des arrondissements -peut-être- les plus riches de Paris, culturellement parlant. Le public est là, le lieu existe, reste à les faire se rencontrer. Ce n’est pas une simple réouverture de salle, Paris-Louxor le dit bien, c’est « vivre ensemble le cinéma ». Il faut y croire !