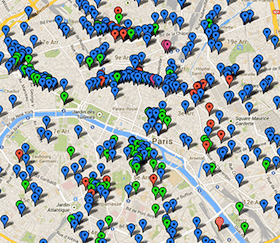Jeudi 4 mai 2017, devant le magasin Tati de Barbès. Alors que les salariés de Tati se mobilisent pour sauvegarder leurs emplois suite à la mise en redressement judiciaire de la marque, nous publions un texte de l’anthropologue Emmanuelle Lallement sur les liens entretenus entre l’emblématique enseigne de Barbès et son quartier.
TATI ET BARBÈS : DIFFÉRENCE ET ÉGALITÉ À TOUS LES ÉTAGES
« Quel est le “monument” de la capitale le plus visité ? La tour Eiffel, le Louvre, l’Arc de triomphe ? Non, vous n’y êtes pas. L’institution parisienne qui a fait se déplacer trente-cinq millions de visiteurs l’an dernier s’appelle Tati, la grande surface de la fringue à quatre sous », titrait Le Figaro en 1987. Si tout le monde connaît, depuis plus de cinquante ans, les magasins Tati, ce n’est pas simplement parce qu’ils vendent à bas prix des produits de consommation courante. C’est aussi parce que « Tati, c’est le cœur d’un quartier à l’ambiance tropicale que Jules Ouaki a transformé. Barbès, sans les magasins Tati, ne serait plus Barbès » [L’Express, 27/09/1980]. Les gestionnaires de l’enseigne l’ont bien compris en adoptant le slogan « La rue est à nous », une manière de réaffirmer les liens entre les magasins et leur environnement urbain. Aujourd’hui, Tati traverse une crise. Si la chaîne s’est tournée pour un temps, avec l’aide de créateurs comme Azzedine Alaïa, vers une cible jeune et branchée, elle est aujourd’hui confrontée à la concurrence d’autres marques de vêtements bon marché. Des magasins ferment, remplacés par des enseignes de franchise internationales, Courir place de la République, Zara rue de Rennes, peut-être Gap ou H&M ailleurs. Mais comment imaginer le quartier Barbès sans Tati ? C’est à partir de ce cas que j’étudie les liens qui unissent un espace marchand et un espace urbain. Et si je me propose de montrer comment Tati « a fait » Barbès tel qu’on le connaît aujourd’hui, je fais également l’hypothèse que le type de relations sociales qu’engendre Tati dépasse les murs de ces boutiques et se retrouve plus largement dans Barbès. En quoi la sociabilité des magasins Tati est à la fois l’effet et la cause d’une urbanité spécifique dans cet espace désigné sous l’appellation « Barbès » ? Dans la perspective mise en œuvre par Michèle de La Pradelle [1996, 2002], je reprends l’idée que les relations marchandes engendrent des champs de rapports sociaux spécifiques qu’il s’agit de décrire [Bazin, 1996] et je me propose de la mettre à l’épreuve dans l’examen de ce coin du 18e [1] …
Un espace marchand et un quartier
« La rue est à nous », c’est ce qui s’offre à la vue dès qu’on approche du boulevard Rochechouart, en sortant du métro aérien, d’où l’on voit déjà le spectacle du commerce. En effet, autour des magasins Tati qui jalonnent ce boulevard, sur les trottoirs exposant des marchandises de toutes sortes – de la serviette de bain aux collants, de la casserole en inox au calendrier décoré –, c’est le règne du « commerce de la rue ». Dans un désordre apparent, ballet de bacs à roulettes bleu et rose, savamment disposés les uns contre les autres, vendeurs et clients de Tati vont et viennent, sans se soucier du trafic automobile pourtant dense sur cet axe de circulation. Les clients sont attentivement surveillés par les vigiles qui semblent contenir la foule et délimiter le territoire. À croire que l’espace marchand déborde sur la ville elle-même. Les numéros des différentes enseignes au logo Tati (« au 8, vous avez la lingerie, au 12 c’est les bijoux, jusqu’au bout vous en avez », explique une vendeuse du « 10, espace homme ») font office de numéros de rue. La rue Belhomme séparant le magasin femme du magasin homme semble avoir perdu son statut de rue : les voitures ne s’y aventurent guère au milieu des livraisons incessantes de marchandises, des allées et venues de vendeurs et des clients qui, le nez au vent, circulent d’un bord à l’autre, comme s’ils « faisaient » les vitrines d’un centre commercial ou flânaient dans les allées d’un marché. La rue Belhomme semble davantage appartenir aux magasins Tati qu’aux quelques immeubles d’habitation (rares parmi ceux occupés par les bureaux ou la cantine du personnel de l’enseigne) ou qu’au « café de monsieur Luis », certes bistrot parisien, mais surtout extension de Tati, pour employés et clients. Cet univers, composé d’une succession de magasins et de stands extérieurs voyant défiler toute la semaine une foule d’individus de toutes sortes, parisiens et touristes, français et étrangers, habitants du quartier et extérieurs, consommateurs et flâneurs – et ceci dans un espace urbain caractérisé par la densité commerciale et par la présence de boulevards de circulation souvent embouteillés –, semblerait avoir quelques caractéristiques communes avec d’autres espaces parisiens : le boulevard Haussmann, par exemple, aux abords des « grands magasins ». Pourtant, il ne viendrait à l’idée de personne de comparer le Printemps avec Tati, encore moins peut- être le quartier des grands magasins avec Barbès.
Un grand axe typiquement parisien : commerces spécialisés et magasins populaires
« Ça, pour ça, ça a toujours été commerçant Barbès », lance Mme Le Marec à l’instar de beaucoup d’autres habitants anciens du boulevard ou des rues avoisinantes, avant d’ajouter : « Mais c’est vrai que c’est plus pareil, y’a pas à dire. » Depuis son deux-pièces situé au sixième étage d’un immeuble haussmannien – « mais du côté des chambres de bonnes, avec l’escalier de service et non l’ascenseur » – qu’elle habite depuis près de quarante ans, cette femme dit avoir suivi toute l’évolution commerciale du quartier : « J’ai tout connu ici, les bars et les cabarets, les artisans et les petits commerçants, le marché Saint-Pierre, l’ouverture de Tati et puis maintenant tous les bazars et les trucs étrangers. Maintenant, moi je vais rue Ordener pour trouver un vrai steak et un fromage. » La Goutte d’Or comme le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt comme la rue Poulet ont connu jusque dans les années quarante une activité commerciale dense et « traditionnelle ». Comme partout dans Paris, les commerces se concentraient sur les grands axes de circulation, du centre vers les portes de la capitale. On y trouvait les deux grandes catégories d’activités : d’un côté, la vente spécialisée d’articles tels que la graineterie, la poissonnerie, l’ameublement, l’habillement ou bien encore les combustibles ; de l’autre, la vente de produits diversifiés, souvent adjointe à une activité principale. L’épicerie, l’habillement, le textile, la bonneterie et mercerie et les magasins dits populaires y prédominaient [2] . Le premier grand magasin, les Galeries Dufayel, fondé par un certain M. Crespin en 1856, reste dans les mémoires pour avoir donné au quartier Barbès son atmosphère de grande braderie permanente. Les Galeries Dufayel, aujourd’hui disparues, ont constitué ce premier « temple de la consommation » dans lequel, de la batterie de casseroles au mobilier, les ménages ouvriers pouvaient, à crédit, acquérir toutes sortes de biens de consommation courante. « Du palais de la rue de Clignancourt, une armée d’encaisseurs, registre sous le bras et encrier suspendu au gilet, s’élançait chaque matin à travers la ville pour encaisser les échéances hebdomadaires. Au faîte de sa gloire, Dufayel, arrivé à Paris en sabots, pouvait lancer à son conseil d’administration : “Moi, Messieurs, je ne travaille qu’avec les pauvres. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il y a d’argent chez ces bougres-là !” » [Groetschel, 1995 : 25]. Tati est-il une sorte d’héritier des Galeries Dufayel ? Si le fondateur, Jules Ouaki, n’y a jamais ouvertement fait référence, lui aussi disait, à sa manière, que les « pauvres » étaient sa clientèle favorite, en affirmant dans la presse : « Faites venir à moi les voleurs ! » Mais le développement de Tati s’est fait dans un tout autre contexte historique.
Histoire et légende de Tati
Arrivé de La Goulette à Tunis, Jules Ouaki a ouvert son premier magasin en 1949, 50 m2 boulevard Rochechouart, constatant que ce coin de Paris, certes populaire et miséreux, représentait un lieu d’appel. « Je voyais que huit personnes sur dix descendaient à Anvers et deux à Barbès, je me suis dit, il faut trouver un moyen de les faire dévier. Au début, les gens allaient à la Halle Saint-Pierre et venaient faire un tour chez Tati, maintenant, huit personnes sur dix descendent à la station Barbès. » [3] La famille Ouaki elle-même est à l’origine de la légende, rappelant volontiers que le nom « Tati » vient du prénom de la grand-mère, Tita, et ne manquant jamais une occasion de retracer la saga familiale : « 1948. Après des années de privation, la population française se presse aux portes des magasins. Mais tout achat représente encore un effort et elle hésite à franchir le seuil. Aîné d’une famille de neuf enfants, Jules Ouaki comprend parfaitement ces hésitations et invente le premier libre-service textile. Dès le début, les affaires sont prometteuses [...] dans ses petites boutiques, machines à casser les prix qu’il est en train d’inventer à coup de génial bon sens. » [4] Mais la presse a également largement participé à la construction de cette histoire, mettant l’accent sur les origines de Jules Ouaki : « Enfant de La Goulette, banlieue pauvre de Tunis, fils d’artisan bourrelier, Jules Ouaki ouvre son premier magasin à Barbès… Vingt-cinq ans plus tard les 60 m2 de Barbès seront multipliés par 100. Du boulevard de Rochechouart à la place Clichy, il a colonisé ce quartier en rachetant les uns après les autres bars louches et hôtels de passe… » [La voix d’Afrique, 10/1991]. Et, en septembre 1980, L’Express titrait « Le prince de Rochechouart » un article qui le décrivait « comme une sorte de chef coutumier, régnant sur un véritable territoire ». « Lorsqu’en 1948, Jules Ouaki s’avisa d’acheter des articles de lingerie en lots, de les regrouper en trousseaux et de les solder, qui aurait donné cher de sa peau de petit (1,68 m) débrouillard tragi-comique ? En ce temps-là, le quartier de Barbès était encore Montmartre. Le monde était divisé en “caves” et en “affranchis” (l’argot de la pègre au tournant de l’année 1945) » [Le Monde, 21/03/ 1992]. Jules Ouaki aurait, selon la légende, « assaini » le quartier, recevant de l’État français la médaille de l’Ordre du Mérite pour avoir débarrassé le boulevard de ses hôtels de passe et de ses tripots. Depuis la mort du fondateur, Éléonore, sa femme, est présentée sous les traits de la « gardienne du temple »:« Du patriarcat, on est passé au matriarcat », entend-on d’elle dans la presse [Le Monde, 20/12/1995].
L’association Tati-Barbès est certes explicable par des éléments objectivables [5], tels l’histoire de l’implantation de cette famille en France, sa spécificité culturelle, son rôle dans la France de l’après-guerre, dans l’essor du commerce à destination de la clientèle populaire et d’origine immigrée. Mais la légende, à la fois récit familial et récit médiatique, qui a longtemps fait office de success story, a contribué au lien symbolique entre le commerce et le quartier. Par la présence de Tati, Barbès apparaît presque aujourd’hui comme un nom de marque, connotant un certain type de commerce et d’atmosphère urbaine, qui n’est pas un monde de l’entre-soi. À la clientèle traditionnellement populaire (qui certes était déjà présente depuis Dufayel, Dreyfus et Moline du marché aux tissus Saint-Pierre) s’est jointe au fil des années une population d’origine immigrée, ensuite aussi une clientèle plus « branchée », jeunes urbains attirés par le côté décalé de la marque. La famille Ouaki a ainsi conçu un dispositif commercial à destination d’une clientèle la plus large possible et ceci en jouant sur la logique de l’ouvert, de l’abondance, de l’accumulation et du bas prix.
« On a aboli la vitrine »
« “Aux magasins Tati, tout valse” ! Les vitrines d’abord… Les comptoirs se répandent sur le trottoir et il suffit d’un pas de côté pour plonger jusqu’au cou dans des bacs aux étiquettes minimalistes, “le pull”, “la culotte”, au-dessus desquels semblent flotter comme des anges auxquels on ne demande pas leur sexe, les corps roses de mannequins en celluloïd » [Catalogue 50 × 50, op. cit.]. C’est bien cette idée de magasins aux larges portes grandes ouvertes qu’a eue Jules Ouaki dans les années cinquante, alors que la population française était encore habituée au modèle de la petite boutique et de son seuil à franchir [Coquery, 2000]. Dans les magasins Tati, les vitrines sont remplacées par des étals disposés sur le trottoir, comme sur un marché, dans lesquels les clients peuvent fouiller à volonté, sans souci de bouleverser un quelconque ordre.
« Ici, on casse les prix »
« Après les vitrines, on fait sauter les prix. Jules veut du bonheur pour tous, vite, et leur vend au plus bas prix, “une relation gagnant-gagnant” », souligne aujourd’hui le fils Fabien, PDG. Le « système Tati » a pu pendant de nombreuses années offrir « les plus bas prix » grâce à des marges réduites sur certains articles mais récupérées sur d’autres. « Si j’achète un stock de soutiens-gorge à 1,90 la pièce et que je le revends à 6,90, je récupère la marge que je n’ai pas faite sur des articles plus chers mais que je vends quand même au plus bas prix », explique le PDG. Ces « produits d’appel » ont longtemps eu leur vedette : le collant à 2,90 francs, dont le prix est resté inchangé des années durant. Vendre des produits à des prix si serrés tenait à une relation marchande qui, en amont, liait les acheteurs de la maison à des fournisseurs heureux de liquider leur stock et assurés d’être payés au comptant. C’est cette force d’achat érigée en « philosophie maison » qui permettait de vendre peu cher et, par conséquent, d’assurer une rotation rapide de la marchandise. « Si on voit qu’un produit ne fonctionne pas, c’est-à-dire qu’on ne vend pas une centaine de pièces dans la journée, on casse encore plus le prix, et si ça ne marche pas encore, on remballe », explique une vendeuse. C’est qu’ici, « on fonctionne par coup ».
Tati affiche la ligne 2 en façade, métro, Louxor, Moulin Rouge, Stalingrad #Paris18 pic.twitter.com/Fkb796qG2j
— PARIS-LOUXOR (@parislouxor) 22 mai 2016
« Tous sous la même enseigne »
Depuis le boulevard Barbès jusqu’à la rue Belhomme, les magasins Tati forment un ensemble, sur deux niveaux, de surfaces clairement délimitées entre lesquelles les clients sont invités à circuler librement. Le rez-de-chaussée compte une succession d’espaces désignés par de larges panneaux : « confection femme », « vêtement enfant », « hygiène », « lingerie », « maison » et « confection homme ». Chacun est aménagé au gré des emplacements des bacs amovibles qui tracent les allées parcourues par la clientèle. Suspendues au plafond, des pancartes renseignent sur l’organisation des rayonnages. Ici, les pantalons, là les jupes, plus loin les chemisiers, etc. Les clientes butinent d’un bac à l’autre, dans une relative promiscuité qui favorise quelques échanges de propos. « Ça vaut pas vraiment le coup aujourd’hui. Il vaut mieux revenir la semaine prochaine. » « Oh oui, vous avez raison. Y’a plus toutes les tailles. » Dans les rayons, des hommes et des femmes, de tous âges et d’origines différentes, déambulent à la recherche d’une bonne affaire à saisir. Au premier étage, rayon « mode femme », les allées sont plus clairsemées. Là encore, les clientes n’hésitent pas à fouiller, certaines étirant la dentelle des soutiens-gorge pour en tester la résistance. On se bouscule, on n’hésite pas à jouer des coudes pour trouver la bonne taille, pour sortir du bac ce qui a suscité tant d’énergie. Les articles mis en vrac dans les bacs et présentés sur des mannequins aux formes généreuses mettent en scène un temps hors saison et s’adressent à tous types de clientèle. Des hommes, originaires d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb, occupés à acheter une grande quantité de collants ou de lingerie ou des touristes russes choisissant des combinaisons en satin, semblent tous avoir leur place au milieu des femmes, certaines en boubou, d’autres en tailleur, elles aussi affairées. Ici, on satisfait ensemble, réunis sous une même enseigne, des besoins qui, finalement, sont bien identiques, tout du moins équivalents, à ceux des autres. De la lingerie à la vaisselle, les deux espaces sont contigus. Des lots de bols, des poêles, petites, grandes, à crêpes, des plats à four s’exposent dans cet espace où chacun prête une attention redoublée. Les promotions sur les nouveaux arrivages sont séduisantes. On entend au haut-parleur : « Chez Tati, on peut laisser parler ses envies. » Ici, les envies seraient communes : vaisselle et couverts identiques pour tous, à petits prix, acquis à la même enseigne. Reste à savoir ce qui se passe concrètement entre les gens dans ces commerces. Car s’interroger sur les magasins Tati, c’est aussi s’interroger sur les logiques sociales à l’œuvre dans les différentes boutiques, entre les bacs de collants et les rayons d’ustensiles ménagers, entre les cabines d’essayage de la boutique de robes de mariée et les vitrines de Tati-Or.
Tati-Mariage : la mariée est toujours en blanc
Présentant sa large vitrine et ses portes vitrées grandes ouvertes sur la rue Belhomme, la boutique TatiMariage, inaugurée en 1995, est une des dernières-nées dans le secteur. Le pari consistant à « vendre du mariage » à bas prix pouvait paraître osé. A priori, il brisait un tabou imposant que la préparation de cet événement marquant d’une vie de famille interdise de consommer « à l’économie ». Mais l’expérience commerciale fut concluante pour l’entreprise Tati qui est, avec ses trente mille robes de mariée vendues par an, l’un des plus gros vendeurs en France. Sur une surface de trois cents mètres carrés, cet espace reprend les codes qui ont fait la renommée de la marque : profusion, abondance, bas prix. Ici la robe de mariée comme les accessoires qui l’accompagnent n’ont rien des objets uniques et « sacrés » des boutiques de mariage plus traditionnelles. Passé les étalages de chapeaux, nœuds papillons, pochettes, gants de satin, voilettes, les clients se voient proposer de multiples accessoires liés à différentes célébrations : faire-part de baptême, menus de mariage, cotillons, fleurs artificielles, écrins pour les alliances, dragées, etc. Plus des aubes et des croix en bois pour les futurs communiants ou encore des tenues complètes pour garçons et filles d’honneur. Ici, tout est marchandise et présenté en tant que tel : sur des rayons, dans des boîtes, étiqueté, faisant même régulièrement l’objet de promotions. Si un espace est consacré aux costumes des hommes, ce sont les robes de mariée qui sont au centre du dispositif. La collection, renouvelée chaque année, comprend une cinquantaine de modèles fabriqués pour certains en Chine, pour d’autres dans des ateliers situés, selon une responsable des achats, « à dix minutes d’ici ». Les magasins Tati rachètent aussi par lots, « au dixième de leur prix de revient », des invendus de marques célèbres. Toutes exposées sous plastique, les robes sont classées par taille, et les prix oscillent entre 129 et 299 euros. Les couleurs, les coupes et les matières sont facilement identifiables : du blanc et de l’ivoire, du long et du court, de la dentelle et de la soie. Aucune robe ne sort du lot, toutes sont équivalentes, uniformisées par leur présentation et leur prix. La plupart des futures mariées font leur choix en fonction du type de mariage [Raulin, 1997], de leur goût, de leur morphologie, mais également des avis des spectateurs. Car à proximité de l’exposition de robes, le vestiaire réservé aux essayages est en bonne place dans la boutique. Ce salon s’offre ainsi au regard comme une scène. Les futures mariées, Africaines, Maghrébines, Asiatiques ou issues d’une de ces migrations, Françaises, accompagnées chacune d’une vendeuse, revêtent dans les cabines individuelles, fermées d’un rideau de chintz, la ou les robes présélectionnées. Elles ressortent et marchent sur la moquette rose pour se voir dans un large miroir et pour être admirées par leur famille. Mais, en situation de spectateurs, tous les autres clients et accompagnateurs sont là. Les vendeuses s’emploient à faire participer tout le monde. « Allez-y mademoiselle, venez ! Mais avancez-vous, que l’on vous voie bien ! » Puis, à l’adresse de la mère : « Alors madame, comment vous la trouvez votre fille ? » Une femme répond à sa place : « Oh, comme elle vous va bien ! » Une autre, tout aussi extérieure à la famille, lance : « Ah moi, personnellement, je vous préférais dans l’autre. Mais bon, ça, c’est mon avis personnel. » La mère enfin, hésitante : « C’est difficile à dire. Je les aime toutes les deux. » La vendeuse entretient le jeu, cherchant l’assentiment dans le public tout en livrant ses conseils d’experte : « Avec ce modèle, il faut des gants longs, et puis aussi le cerceau sous la robe pour le gonflant, sans oublier le diadème. Pour les chaussures, il vous faudra du crème, vous verrez ça dans le rayon après… Tenez-vous droite, je vous lace le bustier. » Dans cette mise en scène, chacun semble jouer son rôle, la jeune fille dans le rôle de la future mariée, la mère dans celui de l’admiratrice émotive, le père en spectateur inexpérimenté, l’amie en accompagnatrice compréhensive, la vendeuse en spécialiste autoritaire, le public en partenaire interactif. Ces jeunes filles n’auront ni la même robe, ni le même mariage. Pourtant, ce qui compte dans l’instant semble être l’égalité dans laquelle tout ce petit monde est placé. D’abord les jeunes filles, en tant que clientes, sont chez Tati « toutes traitées à la même enseigne » comme aiment à le répéter les vendeuses, qui passent de l’une à l’autre avec un égal affairement. Ensuite, les parents font également l’objet d’un traitement similaire, égalitaire : tous mis dans la même position d’équivalence face à l’événement incontournable que représente l’achat de la robe de leur fille. Enfin, les spectateurs, amis, étrangers et pourquoi pas badauds, constituant un groupe et, en tant que tel, bénéficiant aussi d’un effacement relatif et ponctuel de leurs différences individuelles. Dans l’événement que représente l’achat de la tenue de mariage, il y a donc une égalité de principe qui réunit ces gens autour du salon d’essayage, spectateurs du ballet des jeunes femmes en blanc. Non pas que les individus soient égaux entre eux, mais bien plutôt que la situation marchande les place dans une situation égalitaire.
Tati-Or : de la consommation des différences à la consommation uniformisée
Dans la boutique Tati-Or, ce fut au contraire, pendant longtemps, non pas l’égalité des individus qui était affichée mais leurs différences. Inaugurée en automne 1994, cette bijouterie est bien dans le style Tati : portes ouvertes, abondance de marchandises, sans oublier les prix : « Des bijoux en or 18 carats certifiés par l’État à des prix Tati ! » proclame la publicité. Plus de 1 500 références d’articles sont présentées, allant de 1,50 euro pour un cœur en or à 1 500 euros pour une chaîne ornée de pierres. Les prix défient la concurrence sur une diversité d’articles : bagues, boucles d’oreilles, colliers mais aussi pendentifs pour tous les styles, toutes les nationalités, toutes les croyances. Croix catholiques et protestantes, étoiles de David, sourates du Coran, mains de Fatima côtoyaient les croix de vie égyptiennes ou encore les reproductions de cartes de la Guadeloupe ou d’Afrique et les signes astrologiques. Dans cette exposition exhaustive des signes, les lettres de l’alphabet, les représentations de ballons de football, de ballerines de danseuse, de bouteilles de Coca-Cola et d’animaux étaient en bonne place, sans oublier les porte-bonheur qui, des coccinelles aux fers à cheval et aux trèfles, en passant par les cornes d’abondance et les dés, se déclinaient selon la forme et la taille de 5,90 euros à 30 euros. Mais surtout le célèbre pendentif en forme de cœur, l’un des bijoux les plus vendus chez Tati-Or, a longtemps volé la vedette aux bagues en diamant et aux bracelets « trois-ors ». Quels qu’en soient le prix et la qualité, tous les bijoux étaient exposés sous vitrine, bien en vue de la clientèle, ici aussi très variée. C’était, semble-t-il, non pas l’égalité des individus qui était mise en avant mais bien plutôt tout ce qui, en quelque sorte, pouvait « faire différence ».
Un marché des différences s’instaurait dans la boutique. Les achats pouvaient être marqués : chacun pouvait être ou paraître différent en achetant un bijou marquant son appartenance à une religion, à un pays ou à une tradition, chacun pouvait aussi, dans le même processus, construire une image de l’autre en tant qu’étranger, en le voyant acheter une main de Fatima ou une croix de communiant. Pour autant, il s’agissait d’achat de marchandises exposées de manière identique, mises en scène dans leur équivalence logique, comme si le statut de ces objets était bien d’être inséparablement symbole (d’une religion, d’un signe astral…) et marchandise, à ce titre vendu, marqué d’un prix et d’un descriptif sommaire. Comme dans la vitrine d’une société multiculturelle, on pouvait, le temps de faire ses courses, « consommer » sa différence et être au spectacle de celle de l’autre, chacun ayant sa place ici. Le traitement équivalent de toutes les différences, dans un espace commercial accessible à tous et dans un quartier pluriethnique, semblait ouvrir un champ de possibles identitaires : la situation marchande permettait à chacun d’affirmer ou non une différence, de ce point de vue-là équivalente à celle des autres. La différence de tous engendrait de fait une situation égalitaire. Mais depuis 2002 la boutique Tati-Or a changé de dispositif commercial et se rapproche symboliquement de la boutique Tati-Mariage, dans sa capacité à produire de l’égalité, non pas à partir de la différence de chacun, mais à partir de la consommation d’objets identiques pour tous. Les bijoux « marqueurs d’identité » ont laissé la place à de la joaillerie plus « classique ». Les vitrines de mains de Fatima comme celles de croix et d’étoiles de David ne forment plus le paysage de la boutique, à présent disposée à l’image d’une bijouterie traditionnelle où les catégories de métaux et pierres précieuses organisent l’espace. Si les vitrines continuent d’être alignées les unes aux autres, leur contenu a changé : diamants au centre, émeraude, rubis, saphir autour. C’est dans une seule et même vitrine qu’on retrouve les porte-bonheur, les signes astrologiques mais également les bijoux dits religieux. Mise en équivalence avec les autres vitrines de chaînes en or, d’anneaux de mariage, de pendentifs, elle présente une catégorie de bijoux parmi d’autres, pas plus à part que celle des bijoux fantaisie dans n’importe quelle bijouterie. Ici, les individus, d’origines différentes, sont donc censés consommer les mêmes objets, à savoir des bijoux en or et pierres précieuses ainsi que quelques rares pendentifs « identitaires », réduits au rang de fantaisie au milieu des bijoux véritables. Ainsi, même et surtout à partir des différences de chacun, chez Tati, les gens consommeraient plus ou moins les mêmes choses, aux mêmes prix, dans un même lieu. Comme chez Tati-Mariage, est mise en scène chez Tati-Or une société dans laquelle une certaine égalité des individus est produite, circonscrite dans le temps et dans l’espace de l’échange marchand. Et cette égalité fictive est le résultat, non pas d’une égalité des individus, mais du traitement égalitaire des objets, des signes et des identités, dans la situation marchande.
 Scène du film Neige de Jean-Henri Roger et Juliet Berto (1981)
Scène du film Neige de Jean-Henri Roger et Juliet Berto (1981)
Barbès : un vaste Tati ?
Qu’en est-il de l’espace urbain qui a vu naître ces différentes boutiques et qui accueille encore les probables derniers magasins Tati de Paris [6] ? Si Barbès reste indissociablement lié aux magasins Tati, c’est sans doute parce que la greffe a, en quelque sorte, pris [7] . Entre les années cinquante et les années quatre-vingt, les magasins Tati se sont étendus, ouvrant des boutiques plus diversifiées (voyages, lunettes, bijoux, jouets, robes de mariée). Sur le boulevard les boutiques de discount et les bazars ont profité de l’afflux de clientèle. L’essor de Tati dans un espace qui a toujours accueilli des populations immigrées semble avoir permis l’implantation de différents types d’entreprise commerciale. Après les Belges, les Espagnols et les Italiens, des immigrés maghrébins ont ouvert des cafés ou de petites échoppes, le plus souvent des épiceries dans lesquelles l’alimentaire côtoyait les objets culturels [Raulin, 1986]. Des juifs d’Afrique du Nord ont également créé des boutiques (bijouteries, étals de tissus). Ce lieu d’achalandage a donc attiré ce que l’on appelle l’entreprenariat ethnique [Ma Mung, 1996], favorisant une certaine spécialisation de Barbès en zone de commerces exotiques et ethniques [Raulin, 2000], mais sans pour autant exclure le commerce plus généraliste. Le boulevard Barbès et ses alentours sont ainsi devenus un lieu d’attraction pour une clientèle populaire mais diversifiée. Un quartier sur le mode Tati s’est donc peu à peu constitué. J’avais analysé [Lallement, 1999] la dynamique relationnelle à l’œuvre autour des bazars, des deux marchés alimentaires et des diverses boutiques qui composent cet univers urbain et j’avais montré que la mise en scène égalitaire jouait, là aussi, sur la rhétorique de la différence.
Barbès est un espace urbain sans réelles frontières et dont chacun peut produire une définition différente. S’il n’est pas à proprement parler un quartier, avec ses délimitations administratives, ses résidents et leur sentiment d’appartenance locale, c’est parce qu’il est avant tout un espace commercial, accueillant chaque jour des commerçants qui n’habitent pas sur place et des clients qui viennent d’un peu partout. Il apparaît comme un regroupement plus ou moins dense de vendeurs, de consommateurs et de badauds, qui se déploie à partir de la station de métro Barbès-Rochechouart. Qui plus est, ce lieu correspond à un type d’activités commerciales. Si, sur le boulevard Barbès, on voit un grand nombre de bazars et de soldeurs, cette forme commerciale tend à disparaître dans le quartier de la Goutte d’Or [Messamah et Toubon, 1990], davantage résidentiel, fait de petites rues et de formes d’habitat diversifiées. Rue de la Goutte d’Or, rue Myrha et rue des Poissonniers on trouve des petites boutiques spécialisées : épiceries africaines (affichant chacune une origine précise : Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, etc.), boutiques de tissus orientaux et africains, boucheries musulmanes, pâtisseries orientales, salons de coiffure et de beauté africains, formant ce que l’on peut appeler une « centralité africaine » [Bouly de Lesdain, 1999]. Cette « ethnicité » n’est pas aussi visible à Barbès, comme si deux réalités urbaines différentes mais toutes deux fondées sur le commerce coexistaient à quelques pas l’une de l’autre. À Barbès, les enseignes des boutiques ne renseignent que rarement sur l’origine et aucune véritable spécialisation ethnique n’est affichée en tant que telle. Des tapis de prière côtoient des services à vaisselle Cristal d’Arques, le patron juif d’un bazar a souvent un employé maghrébin à ses côtés et le propriétaire de la poissonnerie du marché Dejean ne peut se passer ni de son vendeur sénégalais ni de son vendeur breton. Entre les magasins Tati, le marché Dejean, le marché aux tissus et les bazars des boulevards Barbès et Rochechouart, une logique d’ensemble semble se dessiner. En analysant les espaces micro-sociaux qui font Barbès (des étals de marché, des bazars…), il apparaît que l’échange marchand, en ce qu’il pose les partenaires dans une égalité fictive et formelle, ouvre un champ de relations où les signes distinctifs et notamment ethniques sont manipulés de manière à devenir le lot commun à tous. Parce qu’il s’agit d’échange marchand dans un lieu particulier où tout le monde vient d’ailleurs, chacun semble avoir sa place.
Au marché Dejean, à la sortie du métro Château Rouge, les bouchers présentent, dans de larges vitrines réfrigérées, des pyramides de cuisses de chèvres et des ailes de poulet en vrac. Les poissonniers disposent quelques filets de merlan à côté des poissons du Sénégal, souvent congelés, et vendus tels quels. Les stands de fruits et légumes, quant à eux, font rivaliser les patates douces et les piments avec les pommes de terre charlotte et les artichauts de Bretagne. Le temps du marché, lors des différentes opérations d’échange, vendeurs et clients jouent des rôles, souvent caricaturaux, qui reprennent les caractéristiques, notamment ethniques, des uns et des autres. Parce qu’on se trouve à Barbès, dans cet espace offrant des marchandises venues des quatre coins du monde, c’est le jeu autour de la différence qui apparaît comme la carte à jouer. Parce que tout le monde peut se dire d’ailleurs et revendiquer, dans le même temps, une identité ethnique particulière, le pion sur lequel chacun semble miser dans les relations est bel et bien l’identité. Le poissonnier, qui se dit « véritable Breton », sert une cliente d’origine africaine en lui lançant « Les Africaines, toutes pareilles, elles arrivent avec dix balles et elles voudraient repartir avec toute la came », ce à quoi il s’entend rétorquer « Chéri, pour les dix balles, tu penseras à me le vider le poisson ». Chez le vendeur de fruits et légumes, Faouzi aime catégoriser ses clientes selon une anthropologie qui lui est propre : « Les Maghrébines dures en affaires », « Les Françaises pinailleuses », « Les Africaines voleuses », « Les vieilles impatientes ». Quant au Ed de la rue, le vigile de l’entrée y produit également ses propres classifications : « doudou » pour les Africaines, « cousine » pour les Maghrébines, « mamie » pour les personnes âgées. Au marché Dejean, la différence ethnique, mise en avant, souvent soulignée comme simple élément du répertoire communicationnel, est évoquée au même titre que d’autres types de différences, de sexe ou d’âge. Elle semble ainsi perdre, dans les circonstances précises et éphémères du marché, le caractère discriminatoire qu’elle peut avoir dans d’autres situations sociales. Elle est au contraire une pièce centrale pour bâtir une sociabilité de marché, espace de fictive égalité.
Les bazars du boulevard Barbès, eux, exposent dans leurs bacs sortis sur le trottoir une abondance de marchandises hétéroclites, valises, tapis de salon, accessoires de beauté, ustensiles de cuisine, vêtements soldés, gadgets made in Taïwan. Ils font se côtoyer des produits culturellement marqués comme des gants et du savon pour le hammam et des marchandises internationales, à l’image des chaussettes en lots vendues à l’identique dans le monde entier. Autour de ces commerces se met en place non pas une société à proprement parler mais plutôt un « effet de société » [8] [Bazin, 1996]. Les différences sont surexposées dans l’espace public par la logique de l’accumulation. Elles sont détournées en tant que marchandises, vendues à des prix sacrifiés qui ne font pas la différence entre ce qui est à caractère religieux ou culturel et les gadgets (le service à thé oriental à 2 euros, le briquet à 1, la pierre d’alun à 0,50, la grande couscoussière à 30, le service à vaisselle Arcoroc à 20, etc.). Les différences arrivent ainsi à se saturer, formant un espace commun de consommation où, pour pas cher, ce qui est exotique pour l’un, et ordinaire pour un autre, est soumis au même statut, celui de marchandise à échanger. Finalement, les différences deviennent l’objet de consommation généralisée. C’est ainsi que l’on peut voir Barbès : le rassemblement d’individus qui se donnent à eux-mêmes le spectacle de leur propre diversité. Comme si le spectacle de la diversité des cultures garantissait, non pas une égalité réelle des gens, mais la production d’une forme d’égalité, certes minimale, mais nécessaire à l’établissement de relations marchandes. Les travaux de Sophie Bouly de Lesdain sur le quartier de Château-Rouge mettent en évidence une centralité africaine fonctionnant également sur une dynamique marchande qui s’établit à partir des réseaux africains. On voit donc que les mondes marchands produisent chaque fois des « effets de société » différents, mais jouant tous, d’une certaine façon, sur l’égalisation ou plutôt la mise en équivalence des partenaires, comme l’a montré Michèle de La Pradelle [1996] à propos des différents marchés de Carpentras. À Barbès, on aurait une égalisation produite à partir de différences multiples, tandis qu’à Château-Rouge, elle se construirait à partir d’une origine unique africaine.
Barbès serait ainsi un vaste Tati dans lequel, parce que chacun y trouve son identité, chacun accepte d’être traité de façon équivalente ; mais également, parce que chacun y est traité de la même manière, chacun peut y affirmer une identité. Cette façon d’être ensemble dans la ville, créée à partir de la logique commerciale, met en scène une ville à la fois multiculturelle et marchande, les deux dimensions étant ici interdépendantes. Théâtre de l’expérience citadine, vécue comme cosmopolite parce que marchande, nous voici au cœur d’une des modalités de production de l’urbain aujourd’hui.
Emmanuelle Lallement, « Tati et Barbès : Différence et égalité à tous les étages », Ethnologie française 2005/1 (Vol. 35), p. 37-46. DOI 10.3917/ethn.051.0037
Avec l’aimable autorisation de l’auteure.
Avant Tati, le Dupont-Barbès.
________
1. Une première enquête de terrain a été menée entre 1995 et 1998. Une deuxième série d’observations et d’entretiens a été réalisée en 2002.
2. Sources : AFRESCO : Association fran- çaise de recherches et d’études statistiques commerciales, Étude, no 56, juin 1962 ; ainsi que les annuaires commerciaux de 1962 à 1968, Archives de la Ville de Paris.
3. Fabien Ouaki reprenant les propos de son père.
4. « 50 × 50 », catalogue de l’exposition photographique organisée en mai 1998 au musée des Arts décoratifs de Paris, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’enseigne, qui retrace l’histoire de ce « génial inventeur du discount tombé amoureux d’une jeune ouvrière hongroise avec laquelle il bâtira l’empire Tati » (éd. Steidl).
5. Il serait possible, dans une perspective d’histoire sociale, de montrer en quoi l’origine juive tunisienne de cette famille a son importance dans l’implantation de ce type de commerce dans ce type de contexte urbain : maîtrise de la langue française et position d’intermédiaire dans le contexte migratoire de l’époque mais aussi mobilisation de liens familiaux et communautaires.
6. L’entreprise Tati connaît actuellement une grave crise : à la baisse de son activité commerciale s’ajoutent les ennuis judiciaires du patron Fabien Ouaki, que la presse ne manque jamais de relater comme pour continuer à faire de l’histoire de cette famille et de cette entreprise une « saga ». Cf. « Tati ne voit plus la vie en rose », Journal du dimanche, 22/09/02 ; Libé- ration, 26/11/2003 : « Ouaki a tenté hier de rassurer des salariés délaissés depuis l’annonce du dépôt de bilan. »
7. Michèle de La Pradelle expliquait, au sujet du marché de Carpentras, comment l’identité locale de la ville était produite par l’événement que constituait le marché, mais elle notait que la question n’était pas de savoir si le marché était traditionnel ou pas, « car la question n’est pas de savoir s’il y a perpétuation d’une coutume ou implantation ex nihilo, mais si la greffe prend et pourquoi » [La Pradelle, 1996 : 359].
8. Un effet de société serait une situation qui n’est pas instituée mais régie par un jeu social particulier.